18/05/2014
Noé, un film qui déplaît aux monothéistes

 L'explication vient du fait que le realisateur et scénariste Darren Aronofsky (à qui on doit le très bon "Black Swan" et "Requiem for a Dream"), voulant sortir de l'image des habituels "pepla" bibliques en carton-pâte et papier-mâché, a fait le choix de se démarquer en donnant au film un côté paradoxalement plus druidique, voire hindou, que biblique, quitte à prendre quelques libertés avec le récit biblique de la Genèse.
L'explication vient du fait que le realisateur et scénariste Darren Aronofsky (à qui on doit le très bon "Black Swan" et "Requiem for a Dream"), voulant sortir de l'image des habituels "pepla" bibliques en carton-pâte et papier-mâché, a fait le choix de se démarquer en donnant au film un côté paradoxalement plus druidique, voire hindou, que biblique, quitte à prendre quelques libertés avec le récit biblique de la Genèse.
Par sa dimension tant esthétique que philosophique, le film évoque en effet davantage le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson qu'un film biblique. À commencer par des paysages dont les vallées et collines verdoyantes nous rappellent l'Irlande ou l'Écosse que le désert biblique (le film a en fait été tourné en Islande, d'où la présence aussi de paysages volcaniques).
Deux lignées humaines s' affrontent. Faut-il y voir déjà là un polygénisme qui ne dit pas son nom ? Celle corrompue, qui est issue de Caïn, dix générations après son géniteur, est cruelle, violente, épuise les ressources naturelles, et mange de la viande. Les ressources épuisées, leur bétail tué, elle va même jusqu'à recourir au cannibalisme, qui rappelons-le est considéré comme l'horreur absolue dans moult croyances, y compris le paganisme (se souvenir d'Atrée maudit des dieux avec toute sa lignée, pour avoir goûté à la chair humaine).
Bref, elle fait penser aux Orcs et Huru-kaïs de Tolkien. À ceci près - et c'est là le pari intéressant de Darren Aronofsky - qu'ils sont en outre les plus fidèles gardiens de l'orthodoxie monothéiste stricte et absolutiste, et de la soumission totale à un dieu unique. Faut-il y voir un pic adressé au rigorisme islamique, à certains haredim ou encore à certaines églises protestantes américaines ?
Celle d'Abel à laquelle appartient Noé (campé par un Russel Crowe qui n'a pas perdu son coté héroïque désintéressé de Gladiator, Robin des Bois ou Man of Steel), est agro-pastorale, et volontiers panthéiste. Son grand-père Mathusalem (joué par un Anthony Hopkins malicieux et joueur) fait penser par la sagesse qui émane de lui à une sorte de Gandalf (Seigneur des Anneaux là-encore) ou de Yoda par son coté facétieux. Et même, en usant à plusieurs moments clé, de sortilèges, il nous rappelle l'enchanteur Myrddin (Merlin). Bref on comprend pourquoi il n'a pas plu à certains fous-furieux de l'islam, ces derniers dont l'Egypte, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, l'Iran, ayant prononcé des fatwas interdisant le visionnage de l'oeuvre. Quant au Vatican, il s' est montré très "réservé", comme d'habitude, comme il l'avait fait pour la Trilogie du Seigneur des Anneaux, ou pour Avatar...
En somme un film qui pourra plaire à un public de sensibilité païenne ou paganisante, que ce public soit européen, indien, voire judéo-païen ("cananéen").
Bruno MARCIUS (LBTF/PSUNE)
17:45 Publié dans Cinéma, Religion | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : noé, bruno marcius, russell crowe |
22/03/2014
Hercule, un Jésus européen ?

 « Hercules, the legend begins » est enfin sorti sur les écrans français après avoir connu un terrible échec commercial, il y a deux mois, aux Etats-Unis. On pouvait donc craindre le pire, malgré une bande annonce des plus alléchantes. Après avoir vu ce film, que j’ai pour ma part beaucoup apprécié, je m’interroge sur le pourquoi de cette descente en flammes et de ce qui a déplu à la critique.
« Hercules, the legend begins » est enfin sorti sur les écrans français après avoir connu un terrible échec commercial, il y a deux mois, aux Etats-Unis. On pouvait donc craindre le pire, malgré une bande annonce des plus alléchantes. Après avoir vu ce film, que j’ai pour ma part beaucoup apprécié, je m’interroge sur le pourquoi de cette descente en flammes et de ce qui a déplu à la critique.
Bien sûr, dans cette Grèce du XIIIème siècle avant notre ère, il y a de nombreux anachronismes comme des combats de gladiateurs ou encore la conquête de l’Egypte. Si de beaux efforts graphiques ont été faits, on se trouve dans une Grèce de légende, à mi-chemin entre la Grèce mycénienne et la Grèce classique. Et de même, la légende du héros, avec les douze travaux, est absente ou malmenée, alors que de nouveaux éléments s’ajoutent, comme une rivalité entre Héraclès et son frère Iphiclès. Tout cela a pu surprendre un public habitué à ces classiques.
Et pourtant de nombreuses idées audacieuses se sont glissées dans ce film et le rendent passionnant. Ainsi, la vie d’Hercule s’apparente par certains aspects à celle de Jésus. De nombreux films américains, à l’instar de Man of Steel, la comparaison implicite est patente. Dans « Hercules », elle est voulue mais détournée. Alcmène s’unit à Zeus sans que le dieu apparaisse, se manifestant par une tempête accompagnée d’éclairs. Cela ne vous rappelle rien ? De même, Hercule est fouetté et attaché par les deux bras dans une scène rappelant la crucifixion. Mais il en sort vainqueur, brisant ses liens, et écrasant grâce à deux énormes blocs de pierre attachés par des chaînes à ses bras tous ses ennemis. Enfin, il devient concrètement roi à la fin de son aventure, ne se revendiquant pas simplement « roi de son peuple » mais roi véritable.
Bien sûr, ce « Jésus » aux muscles imposants mais sobres, à la pigmentation claire et aux cheveux blonds, n’a pas la même morale. Fils du maître de l’univers, dont il finit par accepter la paternité, Zeus en personne, il tue ses ennemis, jusqu’à son propre père adoptif, combat avec une férocité qui en ferait l’émule d’Arès, et semble quasi insensible à la douleur. Une scène le présente même recevant sur son épée la foudre de Zeus qu’il utilise ensuite comme une sorte de fouet électrique pour terrasser les combattants qui lui font face.
Par ailleurs, la « diversité » est réduite à sa plus petite expression, limitée à des mercenaires égyptiens, crédibles dans leur rôle. Les Grecs en revanche sont tous bien européens, avec des traits parfois nordiques. Il n’est pas question comme dans « Les Immortels » ou « Alexandre » de voir des afro-américains en armure ou jouant les Roxanes. En revanche, on retrouve davantage l’esprit de Troie, l’impiété en moins. En effet, cette fois les athées ont le mauvais rôle à l’instar du roi de Tirynthe Amphitryon. Hercule lui-même, qui ne croit pas dans l’existence des dieux pendant une bonne partie du film, finit par se revendiquer explicitement de la filiation de Zeus et la prouver. En outre, Hercules rappelle par certains côtés le premier Conan, puisque le héros est trahi et fait prisonnier, puis s’illustre dans des combats dans l’arène d’une grande intensité, bondissant tel un fauve pour fracasser le crâne d’un ennemi, mais il reste toujours chevaleresque, protégeant les femmes et les enfants.
A certains moments, le film semble même s’inspirer des traits guerriers qu’un Breker donnait à ses statues. Kellan Lutz n’est sans doute pas un acteur d’une expression théâtrale saisissante mais il est parfaitement dans son rôle. Si les douze travaux se résument à étrangler le lion de Némée, à vaincre de puissants ennemis mais qui demeurent humains, et à reconquérir sa cité, son caractère semi-divin, même si le personnage refuse tout hybris, est non seulement respecté mais amplifié. En ce sens, Hercule apparaît comme un Jésus païen et nordique, mais aussi un Jésus guerrier et vengeur, donc très loin bien sûr du Jésus chrétien. Fils de Dieu, sa morale est celle des Européens, une morale héroïque.
Toutefois, bien sûr, certains aspects modernes apparaissent, comme la relation romantique entre Hercule et Hébé, déesse de la jeunesse qu’il épousera après sa mort dans le mythe grec, et le triomphe de l’amour sur le mariage politique. C’est bien sûr anachronique. Mais « la légende d’Hercule » ne se veut pas un film historique.
Enfin, la morale est sauve puisque dans le film, Héra autorise Zeus à la tromper, alors que dans le mythe classique elle met le héros à l’épreuve par jalousie, afin de faire naître un sauveur. Zeus ne peut donc être « adultère ». Cela donne du sens au nom du héros, expliqué comme « le don d’Héra », alors qu’il signifie précisément « la gloire d’Héra », expression énigmatique quand on connaît la haine de la déesse envers le héros. Pour s’exprimer, Héra pratique l’enthousiasme sur une de ses prêtresses, habitant son corps pour transmettre ses messages. C’est conforme à la tradition religieuse grecque.
Les défauts du film sont mineurs par rapport à ses qualités, graphiques comme scénaristiques, mais ce qui a dû nécessairement déranger c’est qu’il est trop païen, trop européen, trop héroïque, qu’il singe le christianisme pour mieux s’y opposer. Le fils de Dieu est marié et a un enfant (à la fin du film). Le fils de Dieu n’accepte pas d’être emmené à la mort mais triomphe de ses bourreaux. Le fils de Dieu devient « roi des Grecs ». Enfin le fils de Dieu apparaît comme tel aux yeux de tous et n’est pas rejeté par son propre peuple. Ce film ne pouvait donc que déranger une société américaine qui va voir des films où Thor lance la foudre, où Léonidas et ses « 300 » combattent jusqu’à la mort avec une ironie mordante, mais qui reste très chrétienne, très puritaine et hypocrite.
Thomas FERRIER (LBTF/PSUNE)
19:07 Publié dans Anti-mythes, Cinéma, Religion | Lien permanent | Commentaires (1) |
15/03/2014
300. Naissance d’une nation

 La suite attendue du film « 300 » de Zach Snyder, intitulée « l’Avènement d’un Empire » (Rise of an empire), est récemment sortie sur nos écrans. A la musique, Tyler Bates a cédé la place à Junkie XL, qui nous propose une bande originale brillante, finissant en apothéose en mêlant son dernier morceau à une mélodie de Black Sabbath.
La suite attendue du film « 300 » de Zach Snyder, intitulée « l’Avènement d’un Empire » (Rise of an empire), est récemment sortie sur nos écrans. A la musique, Tyler Bates a cédé la place à Junkie XL, qui nous propose une bande originale brillante, finissant en apothéose en mêlant son dernier morceau à une mélodie de Black Sabbath.
Comme dans le premier film, c’est un récit qui nous est proposé, jusqu’à l’extrême fin. La reine spartiate Gorgo raconte ainsi la vie de Thémistocle, le héros athénien du film, jusqu’à ce que ses troupes interviennent d’une manière décisive à Salamine. Les nombreuses invraisemblances et les libertés prises avec l’histoire sont ainsi justifiées. Il faut les admettre pour profiter pleinement du message optimiste du film.
L’ouverture avec un Xerxès décapitant Léonidas mort correspond au récit traditionnel. Quant à la « naissance » du dieu-roi, concept contraire à la tradition zoroastrienne, grande oubliée du film, la jeunesse de Xerxès, assistant impuissant au parcours d’une flèche de Thémistocle perforant l’armure de Darius, son père, est narrée, ainsi que la manipulation dont il est la victime par Artémise, jouée par Eva Green, mégère inapprivoisée avide de sang vengeur.
A l’incendie de Sardes par les Athéniens, qui sera le véritable déclencheur de la guerre avec les Perses, le scénariste a préféré « accuser » Thémistocle, personnage tragique, à la fois responsable des malheurs de son peuple et vainqueur ultime de ses ennemis.
A la grandeur sobre et un peu égoïste de Léonidas dans le premier film, Thémistocle est un idéaliste, rêvant d’une Grèce rassemblée et même d’une nation grecque. Le voici émule avant l’heure d’Isocrate. Son discours sur la nécessaire unité de la Grèce au-delà des querelles de cités rappelle celui des véritables européistes, partisans d’une Europe-Nation. Gorgo est davantage souverainiste, estimant que Sparte a « assez donné », mais elle saura faire son devoir et venir en renfort. C’est ainsi que Spartiates et Athéniens unis écrasent la marine perse, tandis qu’Artémise meure dans les bras de son ennemi.
Et même le traître du premier film, le bossu Ephialtès, sert à sa manière la Grèce en invitant Xerxès à attaquer Thémistocle, alors qu’il sait que ce dernier a prévu un piège dans lequel les Perses vont s’engouffrer. Les Spartiates, à l’instar des Rohirrim menés par Gandalf dans « Les deux tours », arrivent à la rescousse, avec à leur tête une nouvelle Valkyrie, une Gorgo marchant l’épée dressée. Même si la Sparte historique traitait ses femmes avec une quasi égalité, on ne verrait pourtant jamais une femme au combat.
Si le message du premier film était celui opposant 300 Européens au monde entier, la dimension cosmopolite de l’armée perse a été adoucie. A l’exception d’un émissaire perse, vu dans le premier film, les généraux et soldats perses pourraient passer pour des Iraniens. En revanche, le message du second est offensif. Après la résistance, la reconquête. Certes, au bord de l’abîme, tout comme l’Europe ne s’unira qu’à proximité du tombeau, selon Nietzsche. La reconquête et l’unité. Tous les Grecs combattent désormais ensemble. Historiquement, c’est bien sûr faux. Thessaliens et Grecs d’Asie mineure étaient dans l’armée perse, et Thèbes jouait double jeu. La mort héroïque de Léonidas, habilement exploitée par Thémistocle, sert de mythe mobilisateur. La Grèce a eu ses martyrs. L'Europe n'a pas encore eu les siens.
Le message politique de Thémistocle, appliqué à la Grèce mais qui pourrait tout aussi bien l’être à l’Europe, est fort. La ruine d’Athènes, incendiée par Xerxès, est également un moment décisif du film. Bien que nous sachions que Salamine fut une victoire grecque, la dimension tragique de leur combat apparaît nettement. Monté sur un cheval de guerre qui saute de bâteau en bâteau comme s’il était Pégase, Thémistocle pourfend les ennemis de son épée, jusqu’à combattre et vaincre Artémise, tandis que Xerxès s’éloigne, sentant l’ombre de la défaite.
Le film est un hymne à l’unité de l’Europe, ce qui est bien surprenant pour une production américaine, au cœur même de l’assemblée d’Athènes. En pleine crise, la Grèce se retrouve à nouveau comme préfiguration de l’Europe de demain, qui reste à bâtir. Une Grèce qui lutte pour la démocratie autour d’Athènes, aidée d’une Sparte qui pourtant n’y croit guère. L’alliance d’Athènes et de Sparte, c’est l’alliance de l’Union Européenne et de la Russie face à un empire qui menace ses libertés, un empire qui a reçu l’aide de renégats (Artémise, Ephialtès) qui agissent contre leur propre peuple.
Thomas FERRIER (LBTF/PSUNE)
17:17 Publié dans Cinéma, Institutions européennes | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : 300 rise of an empire, thémistocle, grèce, europe, nation |
10/11/2013
Snowpiercer ou l'europhobie en action
Notre camarade européen Christophe nous a transmis une excellente analyse du film Snowpiercer (2013). Je vous la livre.
---
 J'ai été voir Snowpiercer (2013) au cinéma, le concept me paraissant intéressant, à savoir une planète congelée et invivable après une boulette militaro-scientifique visant à endiguer le réchauffement climatique. Ce qu’il reste de survivants sont dans une sorte de train-obus géant (la Machine), voué à rouler sans fin sur une ligne de chemin de fer planétaire, sans autre but que de survivre dans ce système écologique clos. Outre que la salle m’ait paru très peu remplie, que le film est un peu longuet (plus de 2h00), et qu’il semblerait que la garniture chocolat ne tienne pas bien sur la glace framboise, le fait est que la bonne impression du début laisse vite place à un arrière-goût amer... Car ce qui devait être une allégorie politique intéressante se révèle être en fait un mélange de critique sociale (stupidement) simpliste et de masochisme europhobe à outrance.
J'ai été voir Snowpiercer (2013) au cinéma, le concept me paraissant intéressant, à savoir une planète congelée et invivable après une boulette militaro-scientifique visant à endiguer le réchauffement climatique. Ce qu’il reste de survivants sont dans une sorte de train-obus géant (la Machine), voué à rouler sans fin sur une ligne de chemin de fer planétaire, sans autre but que de survivre dans ce système écologique clos. Outre que la salle m’ait paru très peu remplie, que le film est un peu longuet (plus de 2h00), et qu’il semblerait que la garniture chocolat ne tienne pas bien sur la glace framboise, le fait est que la bonne impression du début laisse vite place à un arrière-goût amer... Car ce qui devait être une allégorie politique intéressante se révèle être en fait un mélange de critique sociale (stupidement) simpliste et de masochisme europhobe à outrance.
Analyse rapide.
Le wagon de queue, c’est Germinal de Zola: c’est sombre, sale, bordélique, la bouffe c'est de la protéine en barre gélatineuse, on s'habille de guenilles, et on se fait rosser sévère au moindre faux pas. Donc il y a révolte, normal... La Kapo de service, qui vient pour mater tout ça, est une sorte de psycho-rigide acariâtre sans pitié, d’une mocheté absolue, diablement intelligente et calculatrice, et au discours fascistoïde bien rôdé. Après s'être faite neutralisée, la révolte suit son court, et nous découvrons petit à petit les autres wagons. Là où c'est beau et lumineux, où les gens sont propres, bien habillés et repus, nous y trouvons pêle-mêle: les incontournables soldats fascisants au style GIPN avec hache ensanglantée ; l’institutrice des écoles (une jolie blonde enceinte, mais visiblement coconne) qui transforme les gosses en robots dociles voués au culte du Chef et de la Machine; des fashion victims complétement camées en night-club ; des bourgeois tranquilles préservés des horreurs du monde dans leur petite bulle aseptisée… Sans oublier bien sur le tueur-à-gages blond, charismatique, et insensible à la douleur, l’homme de main au crâne rasé et à la politesse suspecte, etc. Et il n'y a là quasiment que des européens…
Parmi les rares qui ne le sont pas, citons l’éternelle « mama » black, battante et pleine d’empathie (variante féminine de Will Smith), et le technicien asiatique surdoué, sans qui l'histoire ne peut pas avancer... Omniprésents, comme souvent… Bref, il semblerait que la diversité n'ait que du bon, et, excepté le leader de la révolte (un type bien, qui inspire la sympathie), avouons que, pour un Européen, tout cela n'est pas très engageant...
Quant au Boss, The Master of The Machine, quasi Dieu himself, c’est Ed Harris, dans son habituel rôle mi-ange mi-démon « à la Stalingrad ». « Ne l’écoutez surtout pas, coupez lui la langue », entend-on… Un ascète, un fasciste, un vrai de vrai, Lucifer en personne ! Et c’est ainsi qu’on apprend que le vieux du wagon de queue (allez, disons-le, le grand sage des gauches) et le vieux de la locomotive (disons-le aussi, le leader maximo des fascistoïdes droitards…) sont en fait complices pour susciter et canaliser les révoltes, afin de réduire la population et préserver la vie: Ordo ab Chaos... Le but étant de donner les commandes du train au jeune leader de la révolte, la seule ayant réussi jusqu’ici, et qui, par cette sorte de sélection naturelle, leur semble le seul capable de prendre les rênes…
Mais là, vous n’y êtes pas tout à fait quand même : car c’est sans compter l’œil vif de notre ami d’Asie qui, bien entendu, a remarqué depuis plusieurs années un recul progressif des neiges et donc un hypothétique réchauffement des températures. C’est ainsi qu’on pourrait enfin sortir du train et survivre à l’extérieur… Hourrah ! Que du bonheur ! La Liberté approche, tout s'accélère, la révolte part en live sévère, le Führer est tué, on fait péter la seule porte qui donne vers l'extérieur, le train déraille emporté par une coulée de neige, c’est la fin de l’horreur, les gentils vont être libérés, les méchants éliminés, et une nouvelle ère, probablement pleine d’amour et de steaks, va pouvoir commencer… Enfin pas pour tout le monde, car il s'avère que les deux seuls survivants sont une ado asiatique maline et un gamin black libéré de l’esclavage… Le seul blanc restant, si l’on peut dire, étant un ours polaire qui passait par là, les regardant d’un air pataud…
Qu'en conclure? Eh bien, que le spectateur sort de la salle avec l'impression désagréable que les Européens sont tous plus ou moins repoussants et méprisables (même le leader de la révolte a eu son heure cannibale avant de se racheter, ainsi qu’il le confie, larmoyant), que la méchanceté, la bêtise, et l'ingratitude les caractérisent, qu'il n'en restera plus un seul à la fin, et que, finalement, « moins il y en a, mieux ce sera pour tout le monde, et bon débarras ! » Car à la fin de l'histoire, tout recommence au paléolithique, l’humanité nouvelle est asiatique et africaine, et on se dit que désormais, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles... La messe est dite ! Amen ! Bref, dans le genre caricature, et surtout en ces temps d'auto-culpabilisation systématique et d’ouverture inconsidérée à l’Autre, Snowpiercer est un cas d’école, un film de propagande de merde, qui à mon sens a toute sa place dans les poubelles de l’histoire du cinéma !
Finalement, pour rétablir la balance, allez voir Gravity en 3D (2013), avec Ed Harris aussi d'ailleurs, George Clooney et la magnifique Sandra Bullock, et vous repartirez du bon pied. Il ne s’agit pas de nier les problèmes, comme les excès de la stratification sociale, ou le fait que l’espace soit aussi en train de devenir une poubelle, mais simplement de savoir faire la part des choses, loin des pleurnicheries misérabilistes à deux balles et de la haine de soi… Et en cela, Gravity est un film magnifique, qui ne vous fera pas regretter de lâcher 10€ pour "seulement" 1h30 de cinéma... Vous en sortirez grandis, fascinés par le spectacle du cosmos et les prouesses de la technologie, mais aussi questionnés sur les notions de solidarité et de sacrifice, interrogés sur le désespoir, la solitude, la volonté de vivre, sans oublier la part de tragique inhérente à toute aventure humaine.
Christophe (LBTF)
21:31 Publié dans Analyses, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : snowpiercer, europhobie, chris evans, ed harris |
23/06/2013
Le retour de Superman
 Sept ans après le très moyen Superman returns (2006), après dix ans de diffusion de la série Smallville à la télévision, Kal-El est revenu sur les écrans de cinéma. Man of steel de Christopher Nolan et Zach Snyder était très attendu, car de sa réussite dépendrait la renaissance de la franchise. Force est de constater que ce film est à la hauteur des espérances, même s’il a déplu à la critique officielle et « autorisée » et à tous ceux qui prétendent vouloir défendre « l’exception française » en cinéma, ceux-là même qui en réalité trahissent l’esprit européen fondé sur le principe du héros, esprit auquel encore une fois les (Euro-)Américains rendent hommage.
Sept ans après le très moyen Superman returns (2006), après dix ans de diffusion de la série Smallville à la télévision, Kal-El est revenu sur les écrans de cinéma. Man of steel de Christopher Nolan et Zach Snyder était très attendu, car de sa réussite dépendrait la renaissance de la franchise. Force est de constater que ce film est à la hauteur des espérances, même s’il a déplu à la critique officielle et « autorisée » et à tous ceux qui prétendent vouloir défendre « l’exception française » en cinéma, ceux-là même qui en réalité trahissent l’esprit européen fondé sur le principe du héros, esprit auquel encore une fois les (Euro-)Américains rendent hommage.
Par rapport au Superman de 1978, Krypton revisité nous plonge immédiatement dans un monde aux contours franchement étrangers, une planète où règnent les principes de l’archéo-futurisme, entre usines colossales et dragons, nouvelle chevalerie et reproduction ex utero. La destruction programmée de Krypton évoque une planète se refermant sur elle-même, abandonnant l’exploration spatiale, et épuisant ses ressources au point d’avoir irrémédiablement condamné l’existence même de la planète, et ayant perdu toute créativité. Sur Krypton, les enfants ne naissent pas de leurs parents biologiques et sont sélectionnés en fonction des tâches qui leur seront ultérieurement confiés. Ainsi, le général Zod est-il conditionné pour être le protecteur de Krypton, n’ayant aucune liberté quant à choisir son destin et étant prêt à toutes les extrémités, sans morale inhibitrice, pour assurer le salut de son peuple.
Un clin d’œil historique étrange apparaît sous la forme du codex, un crâne qui conserverait tout le patrimoine génétique des Kryptoniens, et dont se saisit Jor-El, remarquablement interprété par Russell Crowe. Or ce crâne n’est autre que celui d’un australopithèque, comme si en vérité les Kryptoniens étaient tout simplement originaires de la Terre, ce qui expliquerait pourquoi ils sont semblables aux humains dans un environnement pourtant sans aucun rapport avec le nôtre. L’origine autochtone est évidemment impossible pour des raisons évidentes d’évolution des espèces. Cette aberration scientifique, que les Comics n’ont jamais expliquée, trouve alors une explication. Par ailleurs, cette volonté dans un environnement de science-fiction de donner une forme de logique et de réalisme, correspond pleinement à la grille de lecture de Christopher Nolan dans sa trilogie consacrée à Batman. Les pouvoirs de Superman, en raison des effets de notre soleil jaune, sont aussi expliqués.
Man of steel insiste peu ou pas du tout sur des aspects traditionnels des films précédents. Exit la kryptonite verte. Exit la forteresse de solitude, remplacée par un vaisseau d’exploration kryptonien de 18000 ans d’âge échoué sur notre planète. Exit Lex Luthor, malgré quelques allusions visuelles à la Lex Corp. Exit surtout l’humour des films précédents, et honnêtement, ce fut une excellente idée.
Enfin, on découvre un Superman qui mérite son surnom. Comme dans les comics, Superman se bat et bavarde peu. Dans son affrontement d’avec Zod et les autres Kryptoniens, il donne tout. Les immeubles de Métropolis sont littéralement détruits par ce choc des titans. Si le super souffle est absent, car ayant été trop sollicité dans les films précédents, la force considérable de Superman est exploitée au maximum. Ce n’est qu’après de longues minutes d’intense combat que Superman réussit enfin à triompher de son adversaire, ce dernier le conduisant toutefois à l’extrémité ultime, Superman étant contraint de tuer Zod pour protéger des innocents.
La relation avec ses parents adoptifs est également bien développée. L’étrange sacrifice de Jonathan Kent afin de préserver le secret de son fils est indéniablement émouvant. Les problèmes scolaires du jeune Clark sont également l’occasion d’exploiter un élément important de psychologie, le trouble identitaire d’un jeune adolescent découvrant des pouvoirs qu’il ne sait pas maîtriser et devant cacher son jeu aux yeux de tous.
D’un point de vue idéologique, Superman apparaît comme le résultat d’une assimilation pleinement réussie, au point où le héros se décrit comme « on ne peut plus patriote », comme tous les habitants du Kansas. A choisir entre une nouvelle Krypton et notre planète, il préfère la seconde au point de sacrifier tout son héritage pour sauver l’humanité.
Il convient de souligner que, dans une Amérique qui change, alors que les dernières données démographiques indiquent qu’en 2040 les américains de souche européenne seront minoritaires, Superman reste avant tout un héros WASP, malgré son origine extra-terrestre. Le film donne d’ailleurs, tout comme dans les Batman de Nolan, une place extrêmement réduite à la « diversité ». Le choix par ailleurs heureux d’un Perry White afro-américain, incarné par Laurence Fishburne, n’est que l’exception qui confirme la règle. Quant aux Kryptoniens eux-mêmes, ils n’ont guère de « diversité » en leur sein, pour ne pas dire aucune. Leurs cheveux bruns éviteront toutefois une allusion trop explicite à un certain régime du passé. Ce Superman européen, trop européen pour plaire à Libération, nous offre ce que tous les fans de l’homme à la cape attendaient. La dimension héroïque du personnage est clairement assumée, au prix d’une romance avec Lois Lane réduite au minimum, la charmante Amy Adams ayant néanmoins un rôle clé. Là encore, Nolan fait le choix du réalisme. Le Superman qui met des lunettes pour devenir Clark Kent et se cacher aux yeux de Lois a disparu. Dès le départ, et avant même que Clark ne devienne Superman, elle sait qui il est et d’où il vient. Son côté journaliste d’investigation hors pair est d’ailleurs remarquablement exploité.
Ce Superman européen, trop européen pour plaire à Libération, nous offre ce que tous les fans de l’homme à la cape attendaient. La dimension héroïque du personnage est clairement assumée, au prix d’une romance avec Lois Lane réduite au minimum, la charmante Amy Adams ayant néanmoins un rôle clé. Là encore, Nolan fait le choix du réalisme. Le Superman qui met des lunettes pour devenir Clark Kent et se cacher aux yeux de Lois a disparu. Dès le départ, et avant même que Clark ne devienne Superman, elle sait qui il est et d’où il vient. Son côté journaliste d’investigation hors pair est d’ailleurs remarquablement exploité.
Quant à la bande originale, les thèmes de John Williams sont abandonnés. L’erreur de John Ottman dans Superman returns aura sans doute été de les conserver, même s’ils sont remarquables et ne seront pas remplacés dans la tradition populaire. Hans Zimmer, tout comme il avait mis de côté les thèmes de Danny Elfman pour Batman begins, repart à zéro. La musique est remarquablement adaptée au film, sachant magnifier le courage des protagonistes, Jor-El d’abord, dans une scène d’action enthousiasmante où il résiste seul à l’armée de Zod, puis Kal-El ensuite guerroyant entre les immeubles ou dans les rues de Smallville.
Man of steel pulvérise Avengers et annonce une suite qui ne pourra être qu’impressionnante. Dans ce concours entre Warner et Disney, malgré l’avance du second, exploitant au maximum la licence Marvel, il n’est pas sûr que DC Comics ne retrouve pas son rang. La trilogie Batman aura payé. Sans la patte de Nolan, il n’est pas sûr que Superman ait pu réussir son grand retour. Cela nous promet une Justice League d’anthologie pour 2015.
Sans être l’incarnation du surhomme nietzschéen, les allusions christiques dominant un personnage aux accents malgré tout apolliniens, ce Superman reste d’une dimension héracléenne. Ce ne sont pas au final les valeurs chrétiennes qui dominent un Superman qu’on retrouve pourtant à au moins deux reprises gisant les bras en croix, et même s’il vient prendre conseil auprès d’un prêtre. Au contraire, il agit plus par devoir que par compassion, avec une dimension romaine qui ne tient pas qu’à son physique, et trouve le sens de sa vie au combat. Certes, il n’est pas non plus un nouveau Conan, malgré cette scène où on le retrouve juché sur une montagne de crânes, avant de s’enfoncer dans le sol.
Avec des effets spéciaux remarquables, notamment exploités pour le montrer volant dans les airs, l’impression de vitesse étant parfaite, ou lorsque Krypton apparaît en début de film, avec un scénario bétonné qui donne une place non négligeable aux souffrances de la jeunesse du héros, dans un jeu constant entre enracinement et respect des valeurs enseignés, Man of steel est un grand film. Il est le Superman que la jeunesse d’Europe en 2013 était en droit d’attendre.
Thomas FERRIER (PSUNE/LBTF)
13:25 Publié dans Billets, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : man of steel, superman, héros, christopher nolan, zach snyder, euro-américains |
16/12/2012
Depardieu en Belgique : tollé chez les « socialistes ».
 Gérard Depardieu quitte la France et renvoie même son passeport. Comme de plus en plus d’artistes français, il en a assez de payer des impôts sur le revenu qui lui paraissent très excessifs. Ce n’est une surprise pour personne que l’exil fiscal soit si répandu aujourd’hui, car le gouvernement « socialiste », par démagogie, préfère cibler les plus riches, faisant ainsi croire de manière mensongère qu’il pratiquerait la justice sociale.
Gérard Depardieu quitte la France et renvoie même son passeport. Comme de plus en plus d’artistes français, il en a assez de payer des impôts sur le revenu qui lui paraissent très excessifs. Ce n’est une surprise pour personne que l’exil fiscal soit si répandu aujourd’hui, car le gouvernement « socialiste », par démagogie, préfère cibler les plus riches, faisant ainsi croire de manière mensongère qu’il pratiquerait la justice sociale.Rappelons en premier lieu qu’un français fortuné qui quitte son pays n’y paiera plus d’impôts du tout. En bilan purement comptable, le taux d’imposition des revenus les plus aisés en France appauvrit les caisses de l’Etat. On peut certes déplorer sur le principe que des français refusent de faire leur devoir citoyen en cotisant pour la patrie. Mais faudrait-il encore que l’argent généré par les impôts soit employé à bon escient. Or, de fait, les Français payent des impôts pour enrichir diverses associations dont l’intérêt n’est pas le nôtre, pour subventionner massivement les banlieues afin d’y garantir une très relative paix sociale, pour dédommager nos anciennes colonies, pour financer la Palestine ou que sais-je encore.
Gérard Depardieu en a assez de payer des impôts excessifs pour cette politique d’assistanat dans tous les domaines. On doit admettre que c’est bien compréhensible.
Et la fausse « gauche », qui ose sans pudeur se dire « patriote », non ne riez pas, de se déchaîner contre « Obélix ». Entendre de la part de Jean-Marc Ayrault que l’attitude de Depardieu serait « minable » est pathétique. Et de Sapin à Filipetti, toute la « gauche » bo-bo mondialiste joue aux indignés.
Oui, cette « gauche » qui a menti aux ouvriers de Florange et s’est couchée devant Lakshmi Mittal. Oui, cette « gauche » qui ouvre ses bras tendres à l’islam tout en tournant le dos aux travailleurs français de PSA. Cette « gauche » qui donne des leçons de morale se déchaîne contre le pauvre Gérard.
Pourtant, ce qu’il a fait est légal, et c’est bien la faute de François Hollande, qui toise Angela Merkel, et qui pratique l’europhobie feutrée, si l’Europe n’est pas fiscalement harmonisée. Depardieu, qui se définit comme un « vrai européen », ce qu’il est, mais aussi comme « un citoyen du monde », ce qui ne veut en revanche rien dire du tout, est allé s’installer en Belgique, car notre voisin a un taux d’imposition plus raisonnable vis-à-vis de personnes fortunées, et préfère les attirer, et obtenir ainsi des subsides supplémentaires, que de les faire fuir.
La « gauche » PS n’aime pas les riches. Elle ne s’aime donc pas elle-même. Mais la « gauche » PS n’aime pas les pauvres non plus, s’ils ont le tort d’être des européens. 35% des français approuvent l’action du président Hollande. La chute continue dans les sondages. Y aura-t’il encore un gouvernement français dans un an ? On se demande en effet si le gouvernement pourra tenir très longtemps en proposant des réformes inutiles, comme le « mariage pour tous », revendication d’une minorité au sein d’une minorité, ou en ouvrant largement les vannes de l’allogénisation.
Un authentique socialiste ne peut que déplorer l’attitude de Gérard Depardieu mais se doit aussi de la comprendre. Et surtout, entendre de la part des mondialistes du PS l’expression « patriotisme » ne peut que révulser tout véritable défenseur de l’européanité de l’Europe.
Des mots mantra comme « nationalisations » ne suffiront pas à convaincre le peuple que ce gouvernement serait à son service.
Face au mondialisme, il n’y a qu’une seule réponse. C’est l’Europe ! Or Hollande freine des quatre fers toute ambition d’une Europe fédérale, et c’est l’Allemagne qui est en pointe du combat pour l’Europe, une fois de plus.
Thomas FERRIER (LBTF/PSUNE)
16:39 Publié dans Analyses, Cinéma, Communiqués | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : gérard depardieu, jean-marc ayrault, françois hollande, thomas ferrier, europe |
11/11/2012
« Skyfall » ou le retour au mythe « Bond »
His name is Bond, James Bond. Dans la continuité de « Casino Royal », et en oubliant la malheureuse expérience de « Quantum of solace », qui n’était vraiment pas au niveau de l’opus précédent, Skyfall est le troisième film avec Daniel Craig dans le rôle de 007, même s’il s’agit officiellement du 23ème film. Et force est de reconnaître que ce long-métrage est très certainement le meilleur de la série, et ce même si Craig n’a pas le charisme exceptionnel de Connery. Il a la chance d’avoir à ses côtés d’excellents réalisateurs et de non moins excellents scénaristes. La différence d’avec les films au scénario squelettique mettant en scène Pierce Brosnan est ainsi saisissante.
Dans la continuité de « Casino Royal », et en oubliant la malheureuse expérience de « Quantum of solace », qui n’était vraiment pas au niveau de l’opus précédent, Skyfall est le troisième film avec Daniel Craig dans le rôle de 007, même s’il s’agit officiellement du 23ème film. Et force est de reconnaître que ce long-métrage est très certainement le meilleur de la série, et ce même si Craig n’a pas le charisme exceptionnel de Connery. Il a la chance d’avoir à ses côtés d’excellents réalisateurs et de non moins excellents scénaristes. La différence d’avec les films au scénario squelettique mettant en scène Pierce Brosnan est ainsi saisissante.
Evoquons rapidement les points contestables de ce film. Le choix d’une Moneypenny issue de la diversité n’est pas des plus heureux, alors que Skyfall retourne au mythe Bond, celui de Ian Fleming. Mais il fallait bien céder à l’air du temps et respecter le quota. Les allusions à une éventuelle expérience homosexuelle de Bond n’étaient pas forcément nécessaires mais s’intègrent à la même logique. Enfin, à l’exception d’une actrice grecque, le casting des James Bond girls évite les actrices européennes, privilégiant le charme épicé d’une franco-asiatique sculpturale. Nous sommes en 2012 et l’idéologie dominante, mondialiste, écrase tout sur son passage, même si le Batman de Nolan a su résister remarquablement à cette pression.
L’inspiration tirée d’autres films paraît évidente à voir Skyfall. Les allusions à Batman sont nombreuses, à savoir un manoir avec des passages secrets, un James Bond jeune tourmenté par la mort de ses parents, un vieil homme qui conserve l’héritage familial, et le caractère célibataire propre au personnage. En revanche, les gadgets sont quasiment absents, à part l’apparition de l’Aston Martin originel, avec son équipement d’époque (siège éjectable et mitrailleuse à l’avant). Le choix du réalisme a été privilégié même si on conçoit mal comment Bond a pu survivre à deux balles tirées dans la poitrine ou à sortir indemne d’une chute dans l’eau glacée. Enfin, le début du film se passant à Istambul rappelle Taken 2 et Liam Neeson en agent américain déjouant la vengeance d’un gang albanais.
Le film repose tout comme The Dark Knight Rises sur la chute du héros. Trahi par son directeur, qui préfère prendre le risque de le faire abattre plutôt que de lui faire confiance jusqu’au bout, alcoolique, incapable de vaincre ses démons intérieurs, cynique et provocateur, Bond est en fin de cycle. Mais, à la différence de Batman, qui raccroche la cape pour préférer les charmes de Selina Kyle, Bond va renaître. Il fallait bien pouvoir proposer un Bond 24 dans deux ans aux spectateurs. Jugé inapte au service, ce que M lui cache, Bond doit revenir au meilleur niveau. Face à un ancien agent devenu un ennemi viscéral du MI6, et connaissant toutes les ficelles du métier, Bond doit parvenir à se sublimer jusqu’à incarner le 007 héroïque de Fleming. Finie la démarche aristocratique de Sean Connery. Fini l’humour britannique de Roger Moore. Craig est dans l’action pure et dure.
Ce retour aux sources est remarquablement illustré par une fin purement écossaise où Bond retrouve sa terre natale et le cimetière familial. Attendant l’ennemi, réfugié dans le manoir de ses ancêtres, afin de protéger M traquée, Bond revoit sa plus longue mémoire avant de faire à nouveau marche avant. Dans un tonnerre de feu, son manoir est finalement brûlé mais tel le phénix, Bond sort indemne des flammes. Il n’empêchera néanmoins pas le M incarné par Judi Dench de céder la place au nouveau M que représente Ralph Fiennes, parfait dans le rôle.
Les dernières minutes du film nous ramènent cinquante ans en arrière, dans l’une des toutes premières scènes de 007 dans « Docteur No ». L’hommage implicite rendu au maître Fleming et au Bond idéal, Connery en personne, est évident. Est-ce à dire que James Bond aura le droit à encore cinquante années nouvelles, et qu’on le découvrira en 2062 sur ce qui aura remplacé nos écrans ? Entre temps, il sera devenu noir, homosexuel et peut-être même musulman.
La chute, la déchéance puis la renaissance de James Bond ne personnifient-ils pas le déclin de l’occident ? C’est bien par un retour aux ancêtres, à la tradition, à la terre natale, que Bond renaît. Cela converge avec la phrase de Nietzsche selon laquelle « l’homme de l’avenir sera celui qui aura la plus longue mémoire ». Et sa renaissance se fait de manière flamboyante au sens littéral. L’éternel retour du même a lieu devant les yeux du spectateur. Bond change mais ne change pas. Le personnage atteint son acmé, ce qui laisse présager d’une suite bien moins reluisante, sauf si Christopher Nolan prend les manettes. Son influence est évidente dans « Skyfall » même s’il n’a été associé ni de près ni de loin au projet.
Thomas FERRIER (LBTF/PSUNE)
17:10 Publié dans Analyses, Cinéma, Culture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james bond, skyfall, m, sean connery, ian fleming |
29/07/2012
Le triomphe du Chevalier Noir
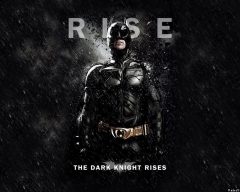
Après le plus conventionnel Batman Begins et le grandiose The Dark Knight, avec la performance d’acteur du regretté Heath Ledger dans le rôle du Joker, Christopher Nolan devait conclure sa trilogie sur un succès. Il était pourtant très difficile de dépasser le second long métrage consacré au chevalier noir de Gotham, tant au niveau du scénario que du jeu d’acteurs, et notamment les palpitantes dernières trente minutes. Il était également nécessaire que Nolan satisfasse les fans de DC et offre à Batman une fin digne de lui, puisqu’il était bien entendu que le troisième film serait aussi le dernier.
Par son choix d’un environnement extrêmement réaliste, Nolan s’interdisait la possibilité d’introduire des personnages trop fantasques comme Poison Ivy ou Victor Fries, tous deux préalablement défigurés par le médiocre Batman & Robin de Schumacher. Il ne fallait donc pas non plus s’attendre à une apparition de Superman à la fin du film pour introduire Man of Steel. En outre, la mort de Ledger rendait difficile la remise en avant du Joker car aucun acteur n’aurait pu crédiblement reprendre le flambeau.
Nolan a donc dû retourner au mythe et s’est ainsi qu’il s’est inspiré des meilleurs comics consacrés à Bruce Wayne, à savoir les cycles Knightfall et No Man’s Land, tout en reprenant son principe d’un terrorisme à grande échelle (post-2001) menaçant Gotham. Il s’agissait aussi de s’inspirer à nouveau de Batman Begins, afin de fermer la boucle. Le film est donc centré sur le personnage de Bane, Tom Hardy ayant enfin un rôle à sa mesure, bien plus valorisant que son rôle timide dans Target. Celui-ci associe force physique et intelligence tactique, face à un Bruce Wayne vieillissant, aux tempes blanchissant, qui a perdu la foi et traîne son corps blessé dans l’intimité de son manoir depuis huit ans.
Batman retrouve ses premières couleurs lorsque Catwoman, alias Anne Hathaway, fait son apparition au cœur de ses appartements. Plus fidèle à la bande dessinée que la blonde Michelle, elle incarne remarquablement la cambrioleuse féline. Retrouvant la tenue de Batman, il se retrouve avec à dos la police de Gotham, qui croit qu’il est l’assassin d’Harvey Dent puisqu’à la fin de The Dark Knight il avait endossé sa mort pour préserver son image de procureur intègre, mais aussi la Ligue des Ombres dont Bane, pourtant officiellement exclu, semble le dirigeant. La confrontation entre Batman et Bane tourne rapidement à l’avantage de ce dernier, qui a en outre réussi à ruiner Bruce Wayne et obligé ce dernier à s’associer avec l’énigmatique Miranda Tate, jouée par Marion Cotillard.
Comme dans Knightfall, la chauve-souris est brisée, paralysée et enfermée au fond d’une prison exotique, sans espoir de s’en libérer, et assistant en outre, par le biais d’une télévision, à la chute de sa cité, prise en otage au sens littéral par un Bane anarchiste, libérant les prisonniers de Blackgate, enfermant les policiers de la ville sous des tonnes de bêton, chassant les riches de leurs appartements, jugeant et condamnant à mort les résistants. Révélant l’innocence de Batman dans la mort de Dent, pensant ainsi salir définitivement la mémoire du commissaire Gordon, Bane ne se rend pas compte qu’il fait de Batman le sauveur de Gotham.
La remontée de Bruce Wayne est certainement le moment à la fois le plus angoissant et le plus majestueux du film de Nolan. Le spectateur souffre avec le héros, constate son impuissance. En quatre mois, Bruce Wayne se reconstruit physiquement mais demeure incapable de se libérer de sa prison. C’est au moment où il comprend ce qu’il a à perdre, lorsqu’il est à nouveau animé d’une pulsion de vie, et se souvenant bien à propos du message nietzschéen de son père sur la nécessité de chuter pour remonter la pente, qu’il parvient enfin à redevenir Batman.
Mais ce n’est pas un Batman solitaire qui ressort du trou béant dont il était le prisonnier. Ce n’est pas un Batman qui attaque bille en tête, comme s’il n’avait rien à perdre. John « Robin » Blake, le commissaire Gordon, l’élite de la police de Gotham, et la charmante Catwoman l’aident dans sa mission. Bane reçoit alors la leçon qu’il mérite mais pour mieux faire apparaître un personnage de l’ombre, Talia Al-Ghûl, fille du méchant du premier film, animée par une vengeance sans pitié et par une forme d’éco-terrorisme.
Nolan offre enfin son mythe à Batman, celui-ci donnant l’illusion d’être mort en sacrifice, tout en sauvant réellement sa cité, libérant Bruce de son nom si lourd à porter, de la malédiction Wayne, et lui permettant de se construire une nouvelle vie aux côtés de Selina Kyle. La scène finale où Alfred effondré, avec un Michael Caine au sommet de son art, découvre Bruce et Selina à la terrasse d’un café en Italie, conclut un film épique sur une note fondamentalement optimiste. Un nouveau héros par ailleurs se lève, avec « Robin », montrant qu’il y aura toujours un Batman à Gotham.
Nolan a pris certaines libertés avec la tradition Batman, négligeant la filiation entre Don Diego de la Vega et Bruce Wayne, l’un et l’autre timides aristocrates le jour et héros au service de la justice la nuit. C’est bien en sortant du film The mark of Zorro que les parents du jeune Bruce sont tués sous ses yeux par Joe Chill, et non en ayant assisté à un spectacle de chauves-souris comme le présente Nolan. Ce dernier synthétise également en un seul personnage le chef de la Ligue des Ombres, l’assassin professionnel Henri Ducart et Ras-al-Ghûl, et enfin associe le mercenaire Bane dès le départ à Talia.
La dimension plus humaine de Batman est ainsi affirmée plus que jamais, à la différence de tous les autres super-héros. Nolan en exagère la dimension sociale car Bruce Wayne ne se prétend pas spécialement bon, et le généreux donateur est avant tout une image qu’il se donne pour cacher ses autres activités. Mais la rédemption par l’amour qui lui est offerte ne peut que satisfaire les aficionados de l’homme au masque. Le couple Batman/Catwoman, très perturbé dans la version de Tim Burton mais aussi dans le nouveau cycle 52 de DC Comics, est explicitement établi à la fin du film.
Enfin, la musique de Hans Zimmer, remarquable dans les deux premiers opus, est à la hauteur du nouveau film de Nolan. Elle diffère fondamentalement de la musicalité héroïque d’un John Williams dans Superman mais surtout de celle de Danny Elfman dans les deux Batman de Tim Burton. Mind if I cut in ?, le quatrième morceau de la bande originale, associe désespoir et chaos en devenir. Rise annonce véritablement la remontée à la surface d’un Batman métamorphosé.
Il sera difficile de reprendre le flambeau de l’adaptation cinématographique de Batman après le chef d’œuvre de Nolan. On ne pourrait imaginer une renaissance du personnage qu’en choisissant de coller de près à la bande dessinée, comme pour Amazing Spiderman. The Dark Knight Rises rappelle toutefois que Batman ne peut pas agir seul, à la différence de Superman, de Wonder Woman ou de Green Lantern, tous dotés de super-pouvoirs. Quatre Robins (Richard Grayson, Jason Todd, Timothy Drake et Damian Wayne, son propre fils) sont nécessaires, de même qu’une Batgirl (Barbara Gordon) et une Catwoman ambigue, pour arriver à maîtriser la criminalité dans Gotham. En tout cas, Nolan a fait rentrer Batman de la plus belle des manières dans le XXIème siècle. Et son message devrait faire réfléchir l’Europe toute entière. A l’heure où le monde européen décline, où sa natalité est en berne, où il subit des flux migratoires comme jamais dans son histoire, où son économie vacille et sa monnaie unique chancèle, il lui faut retrouver la pulsion de vie, pulsion primale, pulsion primaire parfois ; il lui faut « réapprendre la langue du Soleil », comme le disait Robert Sabatier.
Pourquoi tombons-nous ? Mais pour mieux nous relever, voyons. C’est ainsi que la chauve-souris, symbole de protection, devient phénix, symbole de renaissance.
Thomas FERRIER (LBTF/PSUNE)
19:52 Publié dans Billets, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : batman, the dark knight rises, christopher nolan, catwoman, europe |
09/04/2012
La Colère des Titans ou l’athéisme militant

 La suite du Choc des Titans était attendue ; malheureusement, le changement de réalisateur a modifié en profondeur de nombreux aspects du premier film, au point tel que la jonction entre les deux n’est pas des plus aisées, et en premier lieu, la vision donnée des dieux olympiens n’est plus du tout la même.
La suite du Choc des Titans était attendue ; malheureusement, le changement de réalisateur a modifié en profondeur de nombreux aspects du premier film, au point tel que la jonction entre les deux n’est pas des plus aisées, et en premier lieu, la vision donnée des dieux olympiens n’est plus du tout la même.
Dans le premier film, à l’exception des scènes coupées où les dieux sont omniprésents, les olympiens en armures divines apparaissent inspirées en partie de l’univers de Saint Seiya, mais leur divinité n’est en aucune manière niée, même si leur puissance semble dépendre de la foi des mortels à leur égard. Dans le second film, la plupart des dieux ont disparu ou sont déchus. Et surtout l’étrange principe de dieux mortels est affirmé. Cela va même beaucoup plus loin. Si les mortels ont une âme immortelle, les dieux n’auraient qu’une âme éphémère. Une fois morts, ils disparaissent purement et simplement. Or, dans la religion grecque, c’est la mortalité et uniquement elle qui distingue dieux et hommes, les dieux étant éternellement jeunes, et de corps comme d’âme, immortels. Non seulement les dieux peuvent vieillir et s’affaiblir, mais dans le film ils meurent et se transforment en poussière.
La négation de la divinité des dieux est la principale caractéristique d’un film qui est réussi sur un plan graphique, et aussi sur l’utilisation de la 3D, et qui offre de belles scènes d’action. Revenons sur les principaux aspects de ce thème dans le film. En premier lieu, Zeus est trahi par son propre fils, Arès, le dieu de la guerre, trahison qui ne s’explique pas par la nature même du dieu mais par le fait qu’il est un fils mal aimé, jaloux de l’amour qu’a Zeus pour son autre fils, le héros Persée. Des autres fils de Zeus il n’est plus fait question, ni d’Apollon ni d’Athéna, que l’on voit dans le premier film. Il est également trahi par son frère Hadès, qui se venge ainsi de s’être vu reléguer aux enfers, ceux-ci étant d’ailleurs d’esprit fort chrétien, à la fois sombres et rougeoyant de lave incandescente. L’objectif des deux comploteurs est de libérer Cronos, père de Zeus, d’Hadès et de Poséidon. Il faudrait d’ailleurs m’expliquer comment une forme de géant de lave a pu donner naissance à des dieux anthropomorphes ayant la même taille et apparence que les mortels.
Au final, Arès est tué par Persée en combat singulier, et Zeus et Hadès combattent ensemble leur père une dernière fois, même si c’est là encore Persée muni d’un trident de combat synthétisant les trois sceptres des trois dieux principaux (Zeus, Hadès et Poséidon), idée tout à fait originale d’ailleurs. Héphaïstos quant à lui apparaît comme un vieillard un peu fou mais courageux, tué au final par Arès. Les dieux apparaissent donc davantage comme de puissants êtres, mais fondamentalement mortels, rappelant ainsi l’évhémérisme antique, ce courant de pensée repris par les chrétiens et présentant les dieux comme des anciens rois et héros divinisés. C’est la vision exactement contraire de celle du film « Les immortels », où les héros rejoignent les dieux en accédant ainsi à l’immortalité par le fait de mourir au combat. Le directeur de la Colère, Jonathan Liebesman, n’a pas choisi d’adopter la même approche que celui des Immortels, l’indien Tarsem Singh. Le fait que ce dernier soit un indien, certes sikh, a certainement joué de manière déterminante dans la vision qu’il offre des dieux, dont la divinité n’est pas remise en question.
A la fin du film, le père (Zeus) et le fils (Persée) se réconcilient avant que le dieu suprême ne meure dans ses bras. De mémoire, c’est la première fois dans un film que le dieu du ciel meure. Il y a toutefois une allusion christique qui est faite à plusieurs reprises. Au début du film, Zeus est ainsi attaché à une forme d’arbre au cœur du Tartare et voit ses forces littéralement absorbées par Cronos. L’image rappelle étrangement la crucifixion. En outre, à plusieurs reprises, Zeus apparaît comme un vieillard à la barbe blanche, image classique qu’on utilise pour représenter Dieu dans la tradition chrétienne, à rebours du premier film où il apparaît sous une forme majestueuse. La Colère des Titans se révèle donc un film profondément athée et dans lequel le héros agit sans noblesse et en ne s’affirmant tel qu’à l’extrême fin, où il accepte enfin son destin. Il paraît vraiment de plus en plus difficile aux Etats-Unis de proposer un film, ou une série télévisée, dans lequel on prend les dieux vraiment au sérieux, et on les présente conformément à leur nature telle que présentée dans la tradition gréco-romaine, ou même germano-scandinave. Le film de Leterrier n’était pas tombé dans ses travers, mais les annonçait par ce lien fait entre la foi des mortels et la puissance des dieux. Liebesman pousse le raisonnement jusqu’au bout, les mortels n’ayant plus besoin des dieux. Le seul cas de prière, une femme priant Arès de la secourir, n’est d’ailleurs pas récompensé, puisque Arès intervient mais dans le sens exactement contraire, exécutant cette fidèle de son épée. Ceci dit, l’image selon laquelle prier une divinité lui permet de venir à vous immédiatement et en personne est assez innovante.
La Colère des Titans se révèle donc un film profondément athée et dans lequel le héros agit sans noblesse et en ne s’affirmant tel qu’à l’extrême fin, où il accepte enfin son destin. Il paraît vraiment de plus en plus difficile aux Etats-Unis de proposer un film, ou une série télévisée, dans lequel on prend les dieux vraiment au sérieux, et on les présente conformément à leur nature telle que présentée dans la tradition gréco-romaine, ou même germano-scandinave. Le film de Leterrier n’était pas tombé dans ses travers, mais les annonçait par ce lien fait entre la foi des mortels et la puissance des dieux. Liebesman pousse le raisonnement jusqu’au bout, les mortels n’ayant plus besoin des dieux. Le seul cas de prière, une femme priant Arès de la secourir, n’est d’ailleurs pas récompensé, puisque Arès intervient mais dans le sens exactement contraire, exécutant cette fidèle de son épée. Ceci dit, l’image selon laquelle prier une divinité lui permet de venir à vous immédiatement et en personne est assez innovante.
Il faut enfin souligner que dans la vision donnée des dieux olympiens, le film original « La Colère des Titans », avec notamment Ursula Andress dans le rôle d’Aphrodite et Laurence Olivier dans celui de Zeus, restait conforme à la tradition antique quant à la vision qu’il proposait des dieux. On aurait pu moderniser cette image sans pour autant remettre en question le caractère divin des Olympiens. Il est dommage qu’en la matière il y ait eu régression. De tous les péplums modernes, Gladiator reste un film inégalé, par les manifestations de piété religieuse de base qui s’y trouvent. La scène où le chef des gladiateurs prie Mars en touchant le pied d’une statue du dieu en l’appelant « vieux camarade » est mémorable. Maximus honorant les dieux lares, c'est-à-dire ses ancêtres morts, à plusieurs reprises, en est une autre. Dans la version originelle, Scott avait su également ne pas du tout évoquer le christianisme. Dans la version longue en revanche, les poncifs classiques sur les persécutions réapparaissent, avec notamment une scène coupée puis réintroduite où un enfant chrétien est dévoré par un lion. Il est plus que probable que Scott ait au final voulu céder au lobby chrétien.
Thomas Ferrier (PSUNE)
12:14 Publié dans Analyses, Cinéma, Histoire, Religion | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : la colère des titans, liebesman, leterrier, singh, zeus, arès, persée, le choc des titans, thomas ferrier, psune |



